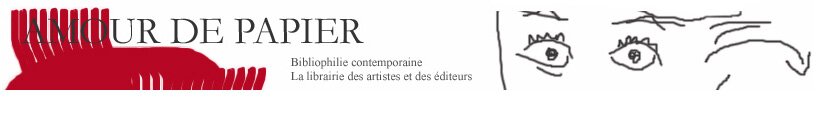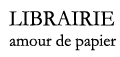Jean-Pierre Milovanoff
Par enchantement |
1997, ill Thierry Le Saec livre unique
(diffusion Art Point France)
Publications
- Le pays des vivants , 2005 Grasset note de l'éditeur : Un homme s'évade à la faveur d'une tempête de neige. Il s'enfonce dans les grands espaces déserts du Massif central où personne n'aura l'idée de le rechercher. Il tente de rejoindre un certain Kochko, vieux boxeur à qui il a sauvé la vie autrefois. L'imprévisible surgit alors de toutes parts. La vie bouscule le fait divers, une vie bariolée, parcourue de coups de foudre, à l'image des cascades de balles d'une jongleuse et des jeux dans la neige de quelques enfants sourds-muets. Là où le lecteur s'attendrait à un suspense policier, voici que font irruption des êtres fragiles et cocasses comme Bichon le fossoyeur inventif ou Faustine la chanteuse de cabaret. Le fugitif comprendra-t-il qu'il a trouvé mieux que ce qu'il cherchait ? - Dernier couteau, 2004 Grasset - La mélancolie des innocents, 2002 Grasset note de l'éditeur : « Je crois qu'il y a dans toute histoire vraie, ou simplement vécue, une part d'ombre qui ne peut être racontée, à peine s'il est loisible de la désigner de loin, en passant, comme une palpitation noire au bout d'un couloir où le pinceau de notre torche ne parvient pas. Cette part est faite de tout ce que le temps dans sa cruauté n'a pas retenu, ce que les archives ne classeront pas, ce que les témoins n'ont pas vu, n'ont pas dit, n'ont pas compris, ce que les acteurs ont gardé au fond de leur gorge. » Ainsi parle Victorin, le chasseur d'ombres, « l'artiste du souvenir », dans cette chronique familiale qui déploie sur plus d'un siècle un peuple d'enchanteurs, d'amoureuses et d'innocents à la poursuite d'un bonheur que le temps mettra à mal. Difficile d'oublier les fiançailles de l'ancien voleur de chevaux, la douceur de Baptistine « la belle Ottomane », Victor que la guerre rendra fou, Paulin le photographe amoureux, le jeune Léonce qui poursuit les abeilles dans la lumière des heures chaudes. Jean-Pierre Milovanoff ressuscite avec humour et mélancolie ces vies fragiles, comme une dernière photographie avant l'oubli. - Aureline, 2000 Grasset - L'offrande sauvage 1999 Grasset - Presque un manège, 1998, Julliard - L'ange des peupliers, comédie-mystère , 1997, Julliard - Le Maître des Paons, 1997, Éditions Julliard ., poche Pocket - La splendeur d'Antonia, 1996, Julliard - Cinquante mille Nuits d'amour et autres pièces, théâtre, 1995, Julliard - La Rosita, Russe blanc (portrait de son père)1994, Julliard.(épuisé) - L'Ouvreuse , 1993, Julliard .- Rempart mobile, 1978, Éditions de Minuit . - La fête interrompue, 1970, Éditions de Minuit. Entre deux appel, entre deux mondes Nous vivons entre deux appels, entre deux mondes, celui qui va naître pour d'autres et celui qui meurt en nous depuis le début et qui refuse de fermer la porte derrière lui. Dans le monde ancien, il y a des voix, il y a des visages, il y a des récits et des tragédies que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne voulons pas oublier. Dans le monde qui naît devant nous, les voix sont confuses, les visages convulsés. On dirait qu'un attentat a eu lieu, on ne sait pas où, qu'une bombe a éclaté, personne n'a rien entendu, parler à quelqu'un est suspect, s'attarder devient dangereux. Dans l'indifférence pressée des citadins, le futur est là, temps silencieux, conjugaison encore imprononçable qu'il va falloir apprendre pourtant. Oui, il y a bien deux mondes pour chacun. Et pour aller de l'un à l'autre, il nous manque les premiers mots. Où les trouver ? Sur quoi prendre appui ? A seize ans, dans la grande maison en ruine sous les platanes, qui était le décor somptueux (quoique dévasté) de mes rêveries, je lisais Le théâtre et son double d'Antonin Artaud, dont le début s'apparente à un bris de glaces. « Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on n'a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie. » A l'origine de ce mépris, assez nouveau dans l'histoire de la parole, il y a la conviction que le langage ne peut servir qu'à baliser, rapporter ou communiquer ce qui a lieu en dehors de lui, qu'il n'est qu'un moyen d'enregistrement et de restitution du réel, et qu'en somme il ne compte pour rien puisque l'activité économique est la seule réalité. Outre que rien n'est plus faux, car le langage est tout sauf une courroie de transmission dépourvue de frottements, aucune communauté, en aucun siècle, n'a prospéré dans le lit de la stricte réalité. Les époques de haute civilisation furent toujours des moments d'extrême attention au langage. Les siècles d'or sont des siècles de poésie. L'Esprit bat pavillon dans la langue, y tient ses assises, ses fêtes, y rencontre ses épreuves Dans la Grèce ancienne, au temps où l'inspiration créait les dieux qui soutenaient l'inspiration, les illettrés qui formaient de très loin le plus grand nombre n'étaient pas exclus des grands rendez-vous de la langue. Il faut supposer un cercle attentif de marins et de paysans autour des récitants errants de l'Illiade, même si l'épopée glorifie les guerriers nobles et non l'homme du commun. Et c'était bien la même foule sans instruction qui assistait aux Jeux Olympiques et qui acclamait les éloges versifiés écrit spécialement pour les vainqueurs. Les quatorze mille spectateurs du théâtre d'Épidaure donnent les dimensions d'une écoute qui s'est perdue. Comment imaginer un public de corridas attentif à des tragédies ? Et il ne s'agit nullement de textes connus, offerts au ressassement commémoratif comme aujourd'hui où toute énergie s'engloutit dans le répertoire. Pour les Grandes Dyonysies, des milliers d'Athéniens de tous les groupes sociaux (moins les esclaves il est vrai, ce qui fait du monde, mais y compris les femmes, les métèques, et les démunis qui bénéficient de l'impôt pour le théâtre) découvrent pendant quatre jours une quinzaine de pièces nouvelles, tragédies, comédies et chants lyriques, totalisant quelque vingt mille vers ! Le fameux « miracle grec » était d'abord le miracle du chant dans la langue, le miracle du partage de l'infini dans la pensée.
Pendant des siècles, tout ce qui touche à l'exercice effervescent de la parole, jeux de mots, joutes, harangues, baratins, fatrasies, comptines, onomatopées, combinaisons du sens et des sons, fait l'objet des passions et des rivalités les plus violentes. Et comme on pouvait le constater encore en Roumanie très récemment, nulle noce n'avait lieu sans le rappel d'une épopée en coin de table.
Parce que nous sommes séparés de nous-mêmes par l'obscurité de la mort, la parole qui vient à nous chargée de miroitements et d'échos est furtive immortalité, corps glorieux.Aussi n'avons-nous pas à chercher beaucoup pour retrouver en nous ces heures où quelques paroles d'un chant, d'un récit, projetaient, dans le noir où nous nous tenions, la lumière de tous les siècles. Car il existe au moins un espace dans la cité où la langue reprend ses droits et oppose son démenti à notre déclin : le théâtre, lieu de toutes les expérimentations fabuleuses, tour à tour champ de bataille, abattoir et kiosque à musique (pour le concert des sentiments). Ni le cinéma ni la télévision ni le livre ne remplacent l'art de la scène qui met à vif notre insouciance et nos ruses, s'empare de nos maladies, de nos illusions, de nos doutes, de nos efforts, et les pèse publiquement sur une balance plus vaste. Dans un monde profané, qui envisage son avenir sur le mode d'un présent perpétuel ou d'une catastrophe imparable, la confrontation des registres, la multiplicité bouffonne ou déchirante des points de vue, le resserrement et l'accélération qu'impose la scène dynamitent notre frêle et partiale réalité en créant dans la langue même le ring nécessaire au surgissement du réel. Sous nos yeux affluent les contraires qui nous habitent : les fugueurs et les sédentaires, les anges et les voyous, les rieurs et les tueurs, les méchants dont la victoire est assurée et les innocents qui se sont trompés de planète. Tous ces personnages ressemblent par quelque côté à ceux que l'on croise dans la rue, mais il nous dépassent de la tête parce qu'ils ne sont pas obsédés par l'identité, cette misère, et qu'ils ont la langue de leurs passions. Ce sont pour la plupart des bons à rien, c'est-à-dire des gens comme nous, ces cerveaux fous et raisonneurs, souffrants et distraits, animés par l'espoir et la nostalgie, avec des cruautés de prétention et la vivacité des anges par intérim. Les acteurs sont les messagers d'un monde élargi, que l'on sait perdu depuis le début et pourtant encore à venir. Avec leurs corps pareils aux nôtres, leurs contradictions en miroir, nous les regardons comme des jumeaux somnambules, plus joueurs que nous ou plus effrontés. Nous savons que s'ils ont au bout de leurs désirs et s'ils se perdent devant nous, c'est pour nous sauver et donner encore une chance à tous les actes et à tous les mots auxquels nous avons renoncé. Il faut revenir au théâtre pour redevenir attentif à notre destin dans la langue et saisir le grand mouvement de nos vies, que la scène restitue et rend visible. En ne dédaignant ni le rire ni la grimace, en mêlant le récit, le chant, l'action, les imprécations, les eaux profondes du réel et de l'irréel, la prière et la prophétie, en jouant de la singularité des corps et des voix dans l'incertitude des frontières et le va-et-vient risqué entre les catégories, le théâtre porte au plus haut l'intention (souvent oubliée) de la poésie, qui est de maintenir ouverte, pour tous, dans la langue, la circulation de l'infini. Et puisqu'il reste à créer un enjeu pour le millénaire qui vient, en voici un, digne d'une démocratie. Dans une société intéressée au bonheur et à la santé mentale de ses membres, mais respectueuse des fragilités de chacun, le théâtre ne devrait-il pas être pratiqué par tous, dès les premières années de l'école et jusqu'à la fin de la vie, comme le sport dont il est une variante parlée ? Le plongeur qui descend dans le noir et remonte dans la lumière, l'amoureux qui court à son rendez-vous donnent l'image des métamorphoses du cour qui sont le secret du théâtre. Les enfants comprennent cela, quand ils se déguisent ; et les adolescents, que fascinent les jeux de rôles. En nous faisant entrer de biais dans les passions et les vies les plus déréglées, le théâtre donne une langue, un habit, un nom, une histoire, à l'insularité des corps qui ne sont violents pour de vrai que par l'absence de projets à quoi le présent les condamne et par l'humiliation d'aller sans mots ni rôle à jouer dans un monde de spectateurs. « Je crois que la Littérature, reprise à sa source qui est l'Art et la Science, nous fournira un Théâtre, dont les représentations seront le vrai culte moderne. » Parmi tant de prédictions qui ne se sont pas réalisées, le temps n'est-il pas venu de réactiver celle-ci qui est de Mallarmé ? Un bon mouvement, donc ! Tous au théâtre ! Tous poursuivant une autre vie, brûleurs de planches, brûleurs de langues. Extrait de Presque un manège |